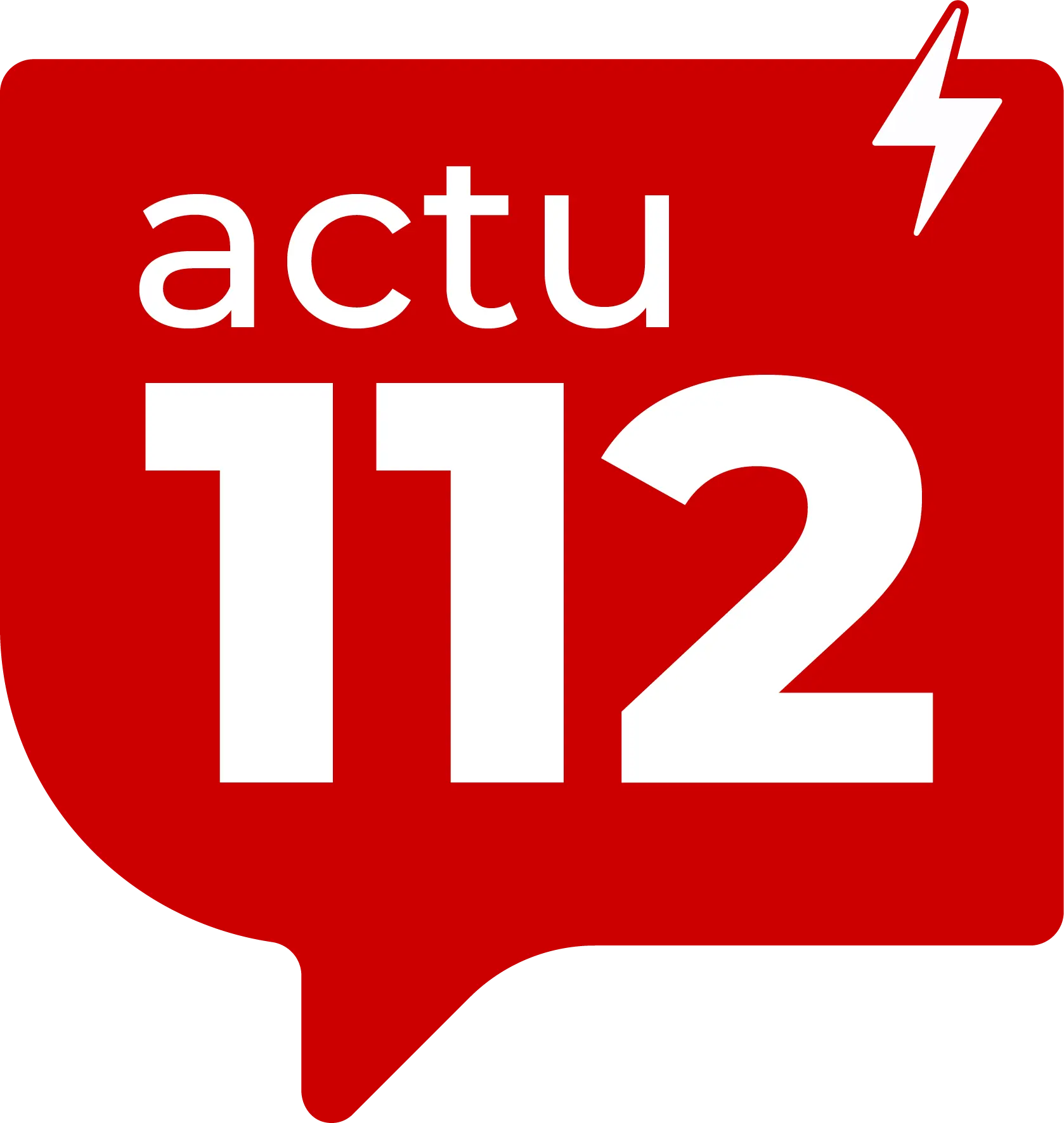Secourisme
Secourisme
Administration d’oxygène par inhalation
Secourisme
Utilisation d’une bouteille d’oxygène
Secourisme
Accident vasculaire cérébral
Secourisme
Crise d’asthme
Secourisme
Crise d’asthme
Secourisme
Douleur thoracique (non traumatique)
Secourisme